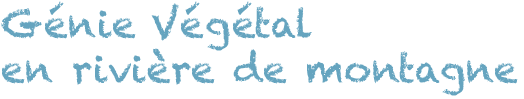Vous êtes ici
1.1.2. La maîtrise de l’érosion en rivière de montagne : constat sur les techniques utilisées
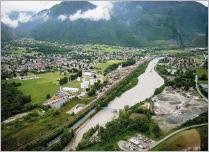 Les rivières de montagne, situées entre les hauts bassins versants torrentiels et la plaine, présentent des contraintes spécifiques du fait de leur situation en fond de vallée et de l’urbanisation croissante des bassins versants alpins (fig. 4). L’espace disponible pour la conservation ou la restauration d’un espace de mobilité du cours d’eau est ainsi souvent limité, faute notamment d’une réelle politique de maîtrise foncière des zones alluviales. Les cours d’eau alpins français sont par ailleurs identifiés comme faisant l’objet d’importantes pressions hydromorphologiques risquant d’empêcher l’atteinte du bon état (AERM&C 2011). Il en va de même pour les rivières suisses.
Les rivières de montagne, situées entre les hauts bassins versants torrentiels et la plaine, présentent des contraintes spécifiques du fait de leur situation en fond de vallée et de l’urbanisation croissante des bassins versants alpins (fig. 4). L’espace disponible pour la conservation ou la restauration d’un espace de mobilité du cours d’eau est ainsi souvent limité, faute notamment d’une réelle politique de maîtrise foncière des zones alluviales. Les cours d’eau alpins français sont par ailleurs identifiés comme faisant l’objet d’importantes pressions hydromorphologiques risquant d’empêcher l’atteinte du bon état (AERM&C 2011). Il en va de même pour les rivières suisses.
En raison de leurs spécificités (régimes hydrauliques parfois torrentiels, fortes pentes, vitesses d’écoulement importantes, forte dynamique, lit mobile, etc.), les cours d’eau alpins sont particulièrement concernés par les phénomènes érosifs. De plus, les caractéristiques des zones de montagne induisent souvent une augmentation des coûts d’intervention et d’entretien par rapport aux territoires de plaine.
Dans le cadre des opérations de protection de berges, le choix des techniques à utiliser repose souvent sur des critères empiriques liés à l’expérience des gestionnaires, aux usages ou encore à des considérations politiques locales. Ainsi, les zones exposées aux phénomènes d’érosion font fréquemment l’objet d’interventions recourant à des techniques lourdes (enrochement, recalibrage, bétonnage, endiguement – fig. 5) alors qu’il existe souvent des alternatives plus douces, plus respectueuses sur le plan environnemental et paysager, et parfois moins coûteuses : les techniques de génie végétal (fig. 6).
D’une manière générale, les techniques de génie végétal appliquées à la protection des berges sont souvent considérées par les maîtres d’ouvrage publics et maîtres d’œuvre français et suisses comme inefficaces sur des cours d’eau dynamiques comme ceux du massif alpin. Or, les niveaux de recours à ces techniques et les types d’ouvrages réalisés sont variables suivant les pays et les régions de l’Arc alpin. En France comme en Suisse, les différentes options d’aménagement apparaissent souvent relever des habitudes locales plutôt que d’un choix raisonné croisant les enjeux sécuritaires, les contraintes physiques, les aspects environnementaux et les coûts associés.